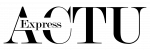La Cour Suprême limite le pouvoir des juges sur les décrets présidentiels
La Cour Suprême des États-Unis a rendu, le vendredi 27 juin 2025, une décision majeure limitant la capacité des juges fédéraux à bloquer les décrets présidentiels à portée nationale. Par un vote de six juges conservateurs contre trois progressistes, la Cour a estimé que les injonctions judiciaires à l’échelle nationale émises par des tribunaux fédéraux dépassent probablement les pouvoirs que le Congrès a conférés aux tribunaux. Cette décision marque un tournant important dans l’équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et l’exécutif, renforçant considérablement l’autorité présidentielle, notamment celle de l’ancien président Donald Trump, dont les décrets sont désormais moins susceptibles d’être suspendus par la justice.
Une limitation du pouvoir judiciaire sur les décrets présidentiels
Jusqu’à présent, les juges fédéraux pouvaient suspendre à l’échelle nationale certains décrets présidentiels contestés, comme ceux émis par l’administration Trump, dans le cadre de contentieux judiciaires. La Cour Suprême a désormais restreint cette capacité, affirmant que lorsqu’un tribunal conclut que le pouvoir exécutif a agi illégalement, il ne peut pas outrepasser ses propres pouvoirs en bloquant de manière générale l’application d’un décret. Cette présomption de validité renforcée des décrets présidentiels permet à l’exécutif d’agir plus rapidement et avec moins d’obstacles juridiques dans la mise en œuvre de ses politiques.
La décision s’appuie sur une affaire emblématique portant sur un décret présidentiel signé le 20 janvier, jour de l’investiture de Donald Trump, qui revenait sur le principe du droit du sol. Ce décret avait été déclaré inconstitutionnel par tous les tribunaux et cours d’appel fédéraux saisis, et suspendu à l’échelle nationale. L’administration Trump contestait cette suspension universelle, la qualifiant de dérive judiciaire, et demandait à la Cour de limiter la portée de cette suspension aux seules personnes ayant saisi la justice. La Cour Suprême a donné raison à cette demande, sans toutefois statuer sur la constitutionnalité du décret lui-même.
Un renforcement de l’autorité présidentielle et ses implications
Cette décision est saluée par Donald Trump comme une « gigantesque victoire » qui rétablit un équilibre plus favorable à l’exercice du pouvoir présidentiel. En effet, elle réduit le rôle des tribunaux dans le contrôle des actions de l’exécutif, ce qui pourrait modifier durablement la dynamique institutionnelle américaine. Le président peut désormais mettre en œuvre ses politiques avec moins de risques d’être bloqué par des injonctions judiciaires à portée nationale.
Cependant, cette évolution suscite de vives inquiétudes parmi les défenseurs de la séparation des pouvoirs. La juge progressiste Sonia Sotomayor, dans un avis dissident, a qualifié la décision d’« invitation au gouvernement à contourner la Constitution », soulignant le risque d’un affaiblissement du contrôle judiciaire et d’une concentration excessive du pouvoir entre les mains de l’exécutif. Les débats à venir porteront sur la portée exacte de cette limitation et sur les mécanismes de contrôle restant à la disposition des juges pour garantir le respect de la Constitution et la protection des droits fondamentaux.
Un contexte politique et international tendu
Cette décision intervient dans un contexte politique américain marqué par des tensions sur le rôle des institutions et la gouvernance. Elle s’inscrit également dans une posture internationale où les États-Unis cherchent à affirmer leur leadership, notamment lors du récent sommet de l’OTAN où Donald Trump a obtenu le soutien des alliés pour augmenter les dépenses de défense. En renforçant le pouvoir présidentiel, la Cour Suprême influence non seulement la politique intérieure mais aussi la posture internationale américaine.
Une tendance à la redéfinition des équilibres institutionnels
Les spécialistes du droit constitutionnel voient dans cette décision une illustration d’une tendance plus large à la redéfinition des équilibres institutionnels aux États-Unis, avec un exécutif plus puissant face à un judiciaire désormais plus limité dans ses prérogatives. Cette évolution pourrait inspirer des débats similaires dans d’autres démocraties confrontées à la question de l’équilibre entre pouvoirs.
Ainsi, la Cour Suprême américaine a profondément modifié le paysage politique et juridique en limitant le pouvoir des juges à bloquer les décrets présidentiels, renforçant l’autorité présidentielle tout en posant des défis majeurs pour la séparation des pouvoirs et la protection des droits fondamentaux.