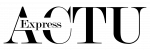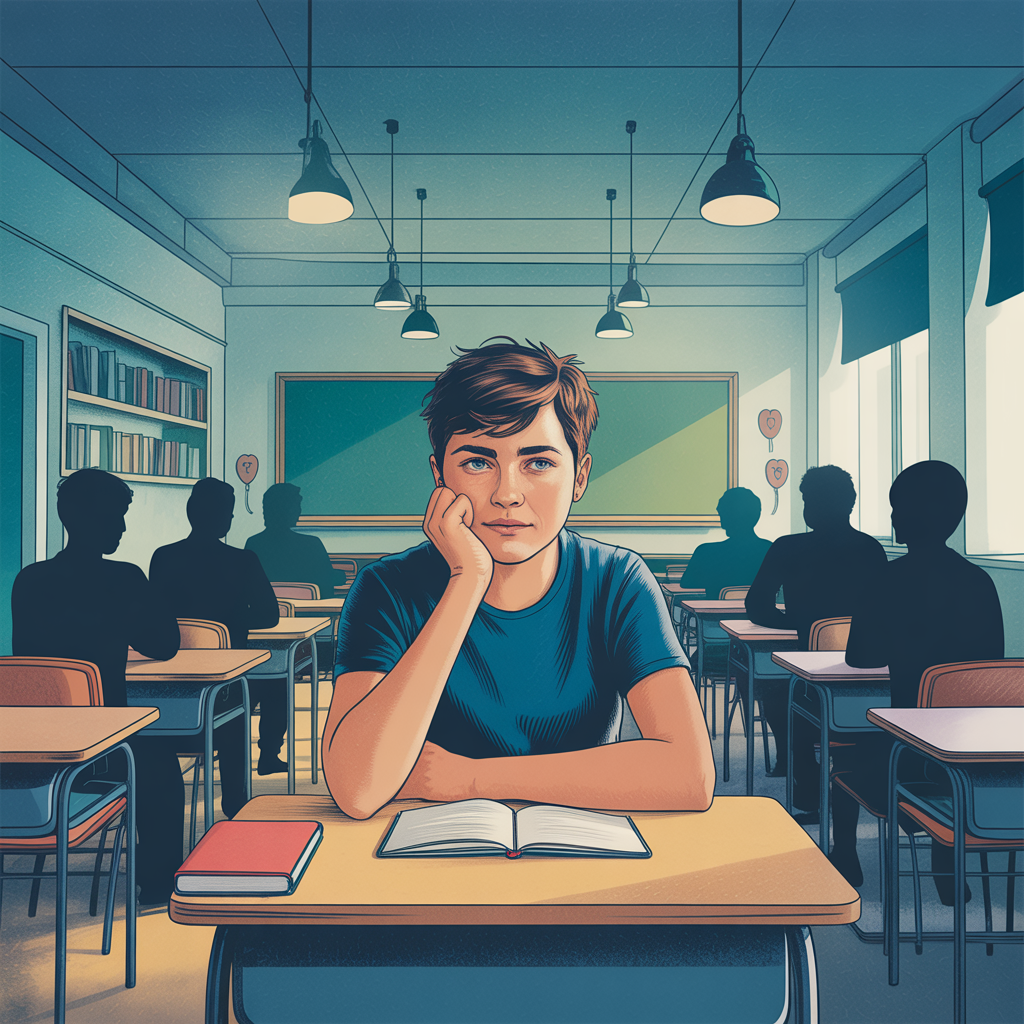Harcèlement scolaire : la réintégration qui divise
La réintégration de deux élèves exclus pour harcèlement scolaire dans leur lycée a provoqué une onde de choc au sein de la communauté éducative française. Cette décision controversée, survenue récemment dans un établissement de l’Essonne, a ravivé le débat sur la gestion du harcèlement en milieu scolaire et la protection des victimes.
Une affaire qui fait réagir
Le 15 mai 2023, deux élèves du lycée Rosa Parks de Montgeron ont été réintégrés dans leur établissement après avoir été temporairement exclus pour des faits de harcèlement. Cette décision, prise par le rectorat de Versailles, a suscité l’indignation des parents d’élèves et du personnel éducatif. Une manifestation a même été organisée devant l’établissement pour protester contre ce retour jugé prématuré.
« Comment peut-on garantir la sécurité psychologique des victimes quand leurs harceleurs reviennent dans les mêmes couloirs qu’elles ? », s’interroge Marie Lefort, présidente d’une association de parents d’élèves. Cette question résume l’inquiétude principale : la cohabitation forcée entre victimes et agresseurs dans un même espace scolaire.
Des chiffres alarmants
Le harcèlement scolaire touche près d’un élève sur dix en France. Selon les dernières données du ministère de l’Éducation nationale, 6 à 10% des élèves sont victimes de harcèlement au cours de leur scolarité, soit environ 700 000 enfants et adolescents chaque année.
Plus préoccupant encore, une étude de l’UNESCO publiée en 2023 révèle que la France se situe au 4ème rang européen en matière de harcèlement scolaire, avec des conséquences parfois dramatiques : 25% des élèves harcelés développent des troubles anxieux ou dépressifs, et le harcèlement est impliqué dans près de 20% des tentatives de suicide chez les adolescents.
Le cadre légal en question
La loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire a créé un délit spécifique de harcèlement scolaire, passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Pourtant, la gestion administrative des cas de harcèlement reste souvent critiquée pour sa lenteur et son manque d’efficacité.
Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation nationale, a récemment rappelé que « la protection des victimes doit être la priorité absolue ». Elle a annoncé en février 2024 un plan de renforcement des mesures anti-harcèlement, incluant la formation obligatoire de tous les personnels éducatifs et la création d’équipes mobiles d’intervention dans chaque académie.
Entre sanction et réhabilitation
La réintégration d’élèves harceleurs pose la question fondamentale de l’équilibre entre sanction et réhabilitation. Pour Gabriel Attal, ancien ministre de l’Éducation, « l’exclusion définitive ne peut être la seule réponse, mais la réintégration doit s’accompagner d’un véritable travail éducatif et d’un suivi psychologique ».
Les spécialistes s’accordent sur ce point. « La sanction est nécessaire, mais elle doit avoir une visée éducative », explique Catherine Verdier, psychologue spécialiste du harcèlement scolaire. « L’élève harceleur doit comprendre la gravité de ses actes et leurs conséquences sur autrui. Sans ce travail de fond, la réintégration est vouée à l’échec. »
Des protocoles insuffisants
Dans le cas des deux élèves réintégrés, c’est l’absence de protocole clair qui a cristallisé les tensions. « Aucune médiation n’a été mise en place, aucun accompagnement psychologique n’a été proposé aux victimes avant le retour des harceleurs », dénonce un enseignant de l’établissement sous couvert d’anonymat.
Le programme pHARe, généralisé depuis 2021 dans tous les établissements scolaires français, prévoit pourtant des protocoles précis en cas de harcèlement. Mais leur application reste inégale selon les territoires et les établissements.
L’impact sur les victimes
Les conséquences psychologiques pour les victimes confrontées au retour de leurs harceleurs peuvent être dévastatrices. « C’est une forme de victimisation secondaire », analyse Jean-Pierre Bellon, président de l’Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement. « La victime peut ressentir un profond sentiment d’injustice et d’abandon institutionnel. »
Dans plusieurs cas documentés, des élèves victimes ont dû changer d’établissement suite à la réintégration de leurs harceleurs, inversant ainsi la logique de protection que l’institution scolaire est censée garantir.
Des alternatives à explorer
Face à ces situations complexes, plusieurs alternatives émergent. Certains établissements expérimentent des « classes relais » temporaires, où les élèves harceleurs suivent un programme spécifique avant une éventuelle réintégration progressive.
D’autres misent sur la justice restaurative, une approche qui implique toutes les parties (harceleur, victime, témoins) dans un processus de réparation encadré par des professionnels. « Cette méthode a fait ses preuves dans plusieurs pays européens », souligne Éric Debarbieux, spécialiste des violences scolaires. « Elle permet de responsabiliser l’auteur tout en donnant une place centrale à la victime dans le processus de résolution. »
Une responsabilité collective
Le harcèlement scolaire ne peut être traité uniquement à l’échelle de l’établissement. « C’est un problème systémique qui nécessite une approche globale », insiste Hugo Martinez, président de l’association Hugo!. « Parents, enseignants, personnel médico-social, élèves : chacun a un rôle à jouer dans la prévention et la détection. »
Les programmes de prévention les plus efficaces impliquent l’ensemble de la communauté éducative et s’inscrivent dans la durée. Ils incluent des formations régulières, des temps d’échanges entre élèves et la mise en place de dispositifs comme les « ambassadeurs contre le harcèlement » ou les « élèves sentinelles ».
Vers une politique nationale cohérente
Le programme interministériel de lutte contre le harcèlement, lancé en 2023, prévoit un investissement de 30 millions d’euros sur trois ans pour renforcer les dispositifs existants. Il inclut notamment la création d’une plateforme nationale de signalement, le déploiement de 250 référents harcèlement dans les rectorats et la mise en place d’un numéro vert (3018) accessible 24h/24.
Mais pour de nombreux acteurs de terrain, ces mesures restent insuffisantes face à l’ampleur du phénomène. « Nous avons besoin d’une véritable politique nationale cohérente, avec des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux », plaide Nora Fraisse, fondatrice de l’association Marion la main tendue.
Conclusion
La réintégration d’élèves harceleurs dans leur établissement d’origine cristallise les tensions autour de la gestion du harcèlement scolaire en France. Au-delà des cas individuels, c’est tout un système qui est questionné dans sa capacité à protéger les victimes tout en offrant des perspectives d’évolution aux auteurs.
L’enjeu est désormais de construire des protocoles clairs, équitables et efficaces, qui placent la sécurité des victimes au centre des préoccupations tout en proposant un accompagnement adapté aux élèves harceleurs. Car derrière les statistiques et les débats, ce sont des milliers d’enfants et d’adolescents qui attendent des réponses concrètes pour retrouver le chemin d’une scolarité sereine.